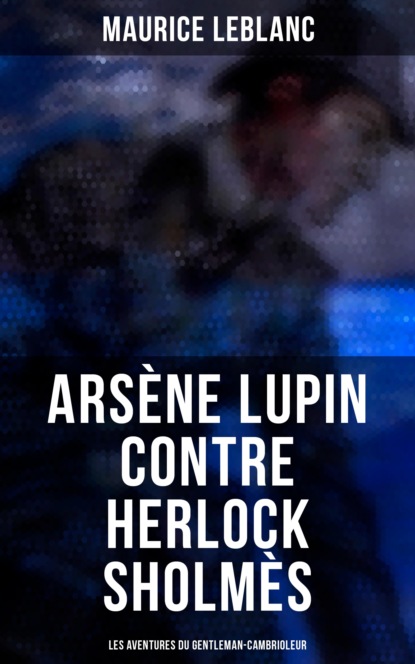compartiment de seconde classe, muni d’un billet pour Amiens. Décidément, mes débuts comme policier promettaient.
Delivet me dit :
– Le train est express et ne s’arrête plus qu’à Montérolier-Buchy, dans dix-neuf minutes. Si nous n’y sommes pas avant Arsène Lupin, il peut continuer sur Amiens, comme bifurquer sur Clères, et de là gagner Dieppe ou Paris.
– Montérolier, quelle distance ?
– Vingt-trois kilomètres.
– Vingt-trois kilomètres en dix-neuf minutes… Nous y serons avant lui.
La passionnante étape ! Jamais ma fidèle Moreau-Lepton ne répondit à mon impatience avec plus d’ardeur et de régularité. Il me semblait que je lui communiquais ma volonté directement, sans l’intermédiaire des leviers et des manettes. Elle partageait mes désirs. Elle approuvait mon obstination. Elle comprenait mon animosité contre ce gredin d’Arsène Lupin. Le fourbe ! Le traître ! Aurais-je raison de lui ? Se jouerait-il une fois de plus de l’autorité, de cette autorité dont j’étais l’incarnation ?
– À droite, criait Delivet !… À gauche !… Tout droit !…
Nous glissions au-dessus du sol. Les bornes avaient l’air de petites bêtes peureuses qui s’évanouissaient à notre approche.
Et tout à coup, au détour d’une route, un tourbillon de fumée, l’express du Nord.
Durant un kilomètre, ce fut la lutte, côte à côte, lutte inégale dont l’issue était certaine. À l’arrivée, nous le battions de vingt longueurs.
En trois secondes, nous étions sur le quai, devant les deuxièmes classes. Les portières s’ouvrirent. Quelques personnes descendaient. Mon voleur point. Nous inspectâmes les compartiments. Pas d’Arsène Lupin.
Sapristi ! m’écriai-je, il m’aura reconnu dans l’automobile tandis que nous marchions côte à côte, et il aura sauté.
Le chef de train confirma cette supposition. Il avait vu un homme qui dégringolait le long du remblai, à deux cents mètres de la gare.
– Tenez, là-bas… celui qui traverse le passage à niveau.
Je m’élançai, suivi de mes deux acolytes, ou plutôt suivi de l’un d’eux, car l’autre, Massol, se trouvait être un coureur exceptionnel, ayant autant de fond que de vitesse. En peu d’instants, l’intervalle qui le séparait du fugitif diminua singulièrement. L’homme l’aperçut, franchit une haie et détala rapidement vers un talus qu’il grimpa. Nous le vîmes encore plus loin : il entrait dans un petit bois.
Quand nous atteignîmes le petit bois, Massol nous y attendait. Il avait jugé inutile de s’aventurer davantage, dans la crainte de nous perdre.
– Et je vous félicite, mon cher ami, lui dis-je. Après une pareille course, notre individu doit être à bout de souffle. Nous le tenons.
J’examinai les environs, tout en réfléchissant aux moyens de procéder seul à l’arrestation du fugitif, afin de faire moi-même des reprises que la justice n’aurait sans doute tolérées qu’après beaucoup d’enquêtes désagréables. Puis, je revins à mes compagnons.
– Voilà, c’est facile. Vous, Massol, postez-vous à gauche. Vous, Delivet, à droite. De là, vous surveillez toute la ligne postérieure du bosquet, et il ne peut en sortir, sans être aperçu de vous, que par cette cavée, où je prends position. S’il ne sort pas, moi j’entre, et, forcément, je le rabats sur l’un ou sur l’autre. Vous n’avez donc qu’à attendre. Ah ! J’oubliais : en cas d’alerte, un coup de feu.
Massol et Delivet s’éloignèrent chacun de son côté. Aussitôt qu’ils eurent disparus, je pénétrai dans le bois, avec les plus grandes précautions, de manière à n’être ni vu ni entendu. C’étaient des fourrés épais, aménagés pour la chasse, et coupés de sentes très étroites où il n’était possible de marcher qu’en se courbant comme dans des souterrains de verdure.
L’une d’elles aboutissait à une clairière où l’herbe mouillée présentait des traces de pas. Je les suivis en ayant soin de me glisser à travers les taillis. Elles me conduisirent au pied d’un petit monticule que couronnait une masure en plâtras, à moitié démolie.
« Il doit être là, pensai-je. L’observatoire est bien choisi. »
Je rampai jusqu’à proximité de la bâtisse. Un bruit léger m’avertit de sa présence, et, de fait, par une ouverture, je l’aperçus qui me tournait le dos.
En deux bonds je fus sur lui. Il essaya de braquer le revolver qu’il tenait à la main. Je ne lui en laissai pas le temps, et l’entraînai à terre, de telle façon que ses deux bras étaient pris sous lui, tordus, et que je pesais de mon genou sur sa poitrine.
– Écoute, mon petit, lui dis-je à l’oreille, je suis Arsène Lupin. Tu vas me rendre toute de suite et de bonne grâce mon portefeuille et la sacoche de la dame… moyennant quoi je te tire des griffes de la police, et je t’enrôle parmi mes amis. Un mot seulement : oui ou non ?
– Oui, murmura-t-il.
– Tant mieux. Ton affaire, ce matin, était joliment combinée. On s’entendra.
Je me relevai. Il fouilla dans sa poche, en sortit un large couteau et voulut m’en frapper.
– Imbécile ! m’écriai-je.
D’une main, j’avais paré l’attaque. De l’autre, je lui portai un violent coup sur l’artère carotide, ce qui s’appelle le « hook à la carotide ». Il tomba assommé.
Dans mon portefeuille, je retrouvai mes papiers et mes billets de banque. Par curiosité, je pris le sien. Sur une enveloppe qui lui était adressée, je lus son nom : Pierre Onfrey.
Je tressaillis. Pierre Onfrey, l’assassin de la rue Lafontaine, à Auteuil ! Pierre Onfrey, celui qui avait égorgé Mme Delbois et ses deux filles. Je me penchai sur lui. Oui, c’était ce visage qui, dans le compartiment, avait éveillé en moi le souvenir de traits déjà contemplés.
Mais le temps passait. Je mis dans une enveloppe deux billets de cent francs, une carte et ces mots :
« Arsène Lupin à ses bons collègues Honoré Massol et Gaston Delivet, en témoignage de reconnaissance. »
Je posai cela en évidence au milieu de la pièce. À côté, la sacoche de Mme Renaud. Pouvais-je ne point la rendre à l’excellente amie qui m’avait secouru ?
Je confesse cependant que j’en retirai tout ce qui présentait un intérêt quelconque, n’y laissant qu’un peigne en écaille, et un porte-monnaie vide. Que diable ! Les affaires sont les affaires. Et puis, vraiment, son mari exerçait un métier si peu honorable !…
Restait l’homme. Il commençait à remuer. Que devais-je faire ? Je n’avais qualité ni pour le sauver ni pour le condamner.
Je lui enlevai ses armes et tirai en l’air un coup de revolver.
– Les deux autres vont venir, pensai-je, qu’il se débrouille ! Les choses s’accompliront dans le sens de son destin.
Et je m’éloignai au pas de course par le chemin de la cavée.
Vingt minutes plus tard, une route de traverse, que j’avais remarquée lors de notre poursuite, me ramenait auprès de mon automobile.
À quatre heures, je télégraphiais à mes amis de Rouen qu’un incident imprévu me contraignait à remettre ma visite. Entre nous, je crains fort, étant donné ce qu’ils doivent savoir maintenant, d’être obligé de la remettre indéfiniment. Cruelle désillusion pour eux !
À six heures, je rentrais à Paris par l’Isle-Adam, Enghien et la porte Bineau.
Les journaux du soir m’apprirent que l’on avait enfin réussi à s’emparer de Pierre Onfrey.